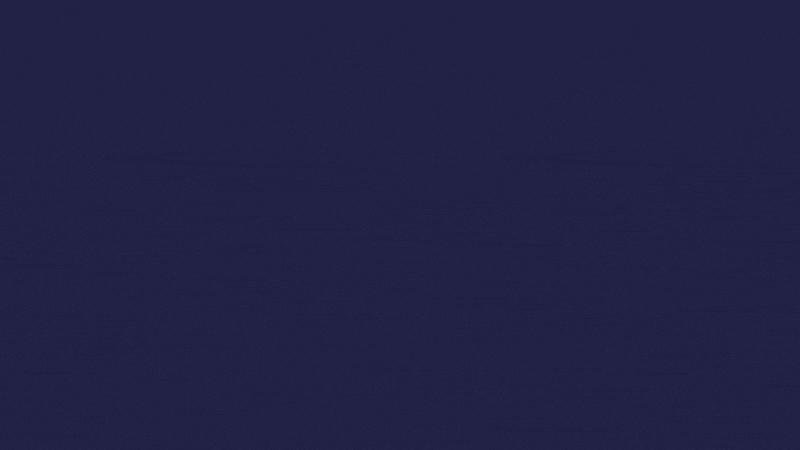En salle depuis le 11 avril, ce long métrage documentaire (96 minutes) aborde avec un regard cinématographique l’Accident Vasculaire Cérébrale. Touchés par ce magnifique projet nous avons choisis de nous y associer pour promouvoir la sortie de ce film et contribué à son succès.
Si vous souhaitez qu’il soit diffusé près de chez vous contactez nous ! !
A ce jour il est sorti à Lyon, Toulouse, Nantes et Paris.
1. Partenariat en construction !
Nous avons proposé à La maison de production des Films du Poisson de construire un partenariat autour du film. Pour mémoire, Je suis, a remporté le prix du long métrage, décerné par le public au festival Un autre regard.
2. « Je suis » : le film, les extraits
« Emmanuel Finkiel nous oblige à regarder ces « handicapés » que, d’habitude, notre regard fuit (…). Il transforme un sujet tabou en voyage passionnant dans la conscience humaine. »
L’Express
« Ephéméride sensible et émouvant de l’évolution de ces hommes et femmes sur un chemin qui les mènera à recouvrer leur conscience et leur identité. »
France info
« Le mélo familial, l’envoûtant mystère qui se dégage des personnages et des couloirs d’hôpitaux, et le film de surpassement à l’américaine s’entrecroisent ici avec grâce et subtilité. »
Ciné obs
« Il y a des documentaires qui repoussent les limites du genre, qui s’attachent à débusquer une réalité à ce point extrême, approchant les limites de l’humain, qu’ils laissent entrer, naturellement, une part de fiction. C’est le cas de Je suis. »
Le Monde
« C’est cette honnêteté, cette rigueur, cette élégance que l’on retrouve dans ce documentaire consacré aux victimes d’accidents cérébraux. »
Télérama
3. L’interview du réalisateur
Après avoir été premier assistant de nombreux réalisateurs, dont Bertrand Tavernier, Krzysztof Kieslowski et Jean-Luc Godard, Emmanuel Finkiel passe à la réalisation avec trois films : Madame Jacques sur la Croisette, Voyages et Casting qui ont reçu un accueil unanime à travers le monde, salués par le public et la critique et couronnés de nombreux prix, dont trois Césars et le Prix Louis Delluc. En 2008, il obtient le Prix Jean Vigo avec son deuxième long métrage Nulle part terre promise. À l’occasion du tournage d’un téléfilm pour France 2, En marge des jours, FIPA d’Or du Meilleur Scénario, Emmanuel Finkiel s’intéresse à ces hommes et ces femmes qui se battent pour revenir à une vie normale après un accident vasculaire cérébral. Je suis, troisième long-métrage du cinéaste dont la sortie est prévue le 11 avril 2012 en France, en est le résultat singulier et incroyablement émouvant.
.
La conscience est au cœur de votre film, et ce dès son titre. Pourquoi ce titre ? Est-ce une manière pour vous de réhabiliter vos personnages dans leur intégrité physique et intellectuelle ? Dès le début la conscience était pour moi la question essentielle. La grande question. Au départ, le titre devait être « donc je suis » qui renvoyait directement au cogito de Descartes. On s’est débarrassé du « donc » parce que c’était très littéraire et conceptuel et surtout j’ai voulu liquider le « je pense ». « Je suis » est l’affirmation de l’incarnation d’un sujet dans le présent. C’est la question que pose le film finalement : à partir de quel moment une personne est une personne ? Ce qui caractérise un sujet, c’est sa vie dans le présent. Notre lieu de vie est le présent. C’est ce que nous partageons avec les personnes du film et qui les rendent intelligibles. Même si elles sont dans un état diminué. Ça me suffit pour dire qu’elles sont des personnes. L’âme on ne sait pas où c’est. Ça est. Le cinéma, l’observation patiente, l’enregistrement attentif par la caméra peut rendre compte de ça. C’est ce que j’ai cherché, saisir les phénomènes qui apparaissent, principalement sur le visage des gens. Le visage, le regard, notre chemin d’accès privilégié vers l’autre. Lorsqu’en feuilletant son album de famille, Chantal tombe sur une photo d’elle et son mari plus jeunes, elle se trouble, sourit et fait un petit geste, très doux, que la caméra enregistre. Là, devant la caméra, en direct, on voit surgir une émotion qui ne semble pas seulement portée par un souvenir.
Maintenant – ici et maintenant – ce type lui fait de l’effet. C’est une réaction de femme face à un homme. Je trouve ça magnifique. Enregistrer ce type de surgissement était mon désir premier pour ce film.
Votre manière de filmer cherche le sensible, l’intime. Les visages prennent effectivement une grande place. Vous réalisez également de nombreux inserts sur les mains. Le cinéma introduit « l’autre ». Moi d’abord, qui saisis les choses en premier et tente de retrouver au montage les impressions premières, retrouver « sa » vérité. Et puis le spectateur, cet autre qui perçoit le film, face à face avec les personnages. Le film fonctionne comme un miroir. Il s’approche des patients apprend à les mieux connaître, en retour ils nous apprennent des choses sur nous. La conscience abîmée de mes personnages renvoie à la nôtre, saine. Réparer les fonctions du cerveau, c’est se réparer. Observer les phénomènes et les comportements du cerveau qui se répare, c’est réfléchir aux mécanismes de notre propre conscience. L’état d’entre deux des personnages, si plein de confusion, n’est pas fondamentalement différent de nos propres confusions quant à nos rapports profonds avec nous-mêmes. Christophe par exemple, le papa, est en proie tout au long du film à des sautes d’humeur terribles qui décrivent en fait toute la palette des émotions humaines, de nos propres émotions. L’enjeu du film, rien d’autre que le retour à la vie comme humain. Un film d’aventure, en quelque sorte. Les gens, sains comme malades, restent des énigmes, l’enregistrement des visages, de la parole et des actes ne révèlent que des traces.
À nous, spectateurs, de nous y confronter, de nous projeter, de nous comparer. Le paysage du film, c’est leurs visages. Je ne me lasse jamais de les filmer. Quand vous regardez dans le viseur de la caméra, en focale un peu longue, avec une profondeur de champ réduite, le flou permet de détacher la personne du fond ; il n’y a pas de visage qui ne soit beau. La notion de l’épiphanie du visage telle que l’a décrite Lévinas, c’est peut-être très abstrait dans la vie de tous les jours, mais je le ressens mille fois dans le travail. J’ai toujours réalisé instinctivement ce type de plans dans mes films de fiction ou mes documentaires. Trop souvent au cinéma, les gens sont saisis comme objets. Je suis permis de dire qu’avant tout, l’existence est là. Avant tout.
C’était selon vous la bonne distance où vous tenir ? En ce qui concerne la place de la caméra, oui. La distance était celle que j’aurais naturellement eue dans la vie. Sans ça, je ne me suis rien interdit, aucune situation, si ce n’est filmer des personnes cérébro-lésées à leur insu, qui n’auraient justement pas conscience de notre présence. Filmer quelqu’un qui n’a pas conscience de ce qui se passe revient à le filmer comme un objet, et je m’y refusais absolument.
Bien que témoin de la souffrance de vos personnages, votre film ne verse jamais dans le pathos et se situe résolument du côté de la vie. Pour faire écho à une phrase de Céline, c’est dans les lieux où les hommes souffrent, comme les hôpitaux ou les prisons, que se trouve la dignité de l’homme et que sa grandeur peut s’exprimer. C’est là effectivement que se manifeste pleinement la vie. Je n’ai pas travaillé au montage pour rendre les choses plus heureuses. J’ai simplement essayé de traquer dans les situations dont j’étais témoin, la vivacité, la vigueur malgré tout, les forces de vie qui sont toujours présentes. Puissantes et opiniâtres. Qu’est-ce qui les poussent ? Qu’est-ce qui les portent toujours vers l’autre, même au cœur des creux dépressifs ? Parfois c’est incompréhensible, ça tient du miracle. La j’ai pu voir que l’amour, par exemple, n’était pas une simple construction mentale, ça existait. C’est plutôt une bonne nouvelle.
Je suis questionne la mémoire et l’identité, de sorte qu’il s’inscrit pleinement dans la lignée de vos précédents films. On revient toujours vers ce qui nous émeut. Ces personnes cérébrolésées sont une espèce d’orphelins, ils éprouvent le manque et le sentiment de perte. Ce sont des thèmes récurrents dans ce que j’ai fait. Elles se trouvent dans la même position que le fils de déportés ou le survivant. Christophe aurait pu être dans le car de Voyages.
Il y a effectivement un fil rouge dans votre cinéma, celui de la réparation, de la restauration. Votre film ne nous abandonne pas avec la souffrance des personnages. Il y a un cheminement vers la vie réparée. Vous avez tout dit. Ces thèmes me collent à la peau. Si ce n’est que pour ce film-ci je parlerais moins de restauration que de renaissance, c’est important, il faut souvent faire le deuil de la personne d’avant, la phrase que l’on entend souvent c’est « ni tout à fait le même ni tout à fait un autre ». Je ne suis pas scientifique, je n’y connais rien, mais si les gens peuvent se rééduquer, c’est grâce à la plasticité du cerveau qui recrée un chemin parallèle à ceux qui sont détériorés. De nouvelles combinaisons sont créées. Ça plaide pour la thèse de la construction.Les personnages et leur famille.
Comment avez-vous choisi vos trois personnages et convaincu leur famille d’apparaître dans votre film ?
Ça s’est fait de manière un peu conjoncturelle. D’abord, on enquête, on s’immerge puis on demande au centre quelles familles seraient susceptibles d’accepter d’être filmées. Peu d’entre elles refusent. Les relations que je noue avec elles m’amènent à suivre une famille plus que l’autre. Je me suis porté vers celles qui étaient très actives et bienveillantes envers leurs proches. Le film montre qu’on n’accomplit rien tout seul : ça se fait toujours avec quelqu’un d’autre, soit un soignant, soit la famille. Dans le film, on sent que rien ne peut se faire sans l’autre, soignants ou proches.
C’est très beau de voir comment la femme de Christophe l’aime pleinement alors même que nous assistons à des scènes très difficiles… Ils sont tous portés par l’amour de leur famille. La femme de Christophe est exceptionnelle, elle n’a jamais cessé d’y croire. Durant les deux années de tournage, je ne l’ai jamais vue flancher. J’étais à l’affût d’un moment de faiblesse ou de lassitude… Jamais ! Et j’ai vu cet homme se redresser.
Quels étaient vos rapports avec la famille des patients ? Les rapports les plus délicats que j’ai eus pendant le tournage, c’étaient avec les parents du « grand » Christophe. Comme vous le remarquez, ils ont une implication gigantesque, c’est leur chair, ils sont très vigilants, très présents, au prix de quelques engueulades avec le centre de rééducation. C’étaient eux qui étaient les plus sceptiques par rapport au film, c’était leur regard que je craignais le plus. Ils avaient peur que leur fils soit ridiculisé.
Ont-ils vu le film ?Il était impérieux que je ne fasse pas un film dans le dos des familles. Avant de finaliser le montage, j’ai pris le risque de leur montrer. S’ils avaient censuré les prises de vue avec leur fils, le film qui s’ouvre et se referme sur Christophe tombait à l’eau. Mais ils se sont dit que c’était un témoignage qu’il fallait garder. Pour eux, ce film est une trace, une mémoire. Quant à l’autre Christophe, le papa, j’étais gêné. Je lui ai demandé s’il ne trouvait pas qu’on le montrait trop en train de pleurer. Il a dit cette chose magnifique pour un type qui ne voulait pas, au début du film, se regarder dans un miroir : « Il faut voir les choses en face ». C’était une réponse très digne. « J’ai été comme ça, tu m’as montré comme ça ». Voilà une nouvelle trace de son évolution.
Au fil du temps, on mesure les progrès des patients. Christophe, le papa de Noah, marche de nouveau et a établi une relation avec son fils ; l’autre Christophe sourit de nouveau. Seule la condition encore fragile de Chantal inquiète. Comment se portent-ils aujourd’hui ?
Aux dernières nouvelles, leur condition correspond assez avec que l’on voit dans le film. Ils progressent chaque jour, Chantal et le « petit » Christophe » sont retournés chez eux. Aux dernières nouvelles lui essayait de se réinsérer professionnellement. Le grand Christophe est toujours dans un centre spécialisé. Peut-être un jour pourra-t-il redonner des cours de tennis… Actuellement, celle qui vit encore avec le plus de déficits, c’est Chantal. Sa volonté de progresser semblait déjà se tarir au moment du tournage. De toute façon l’évolution de ces pathologies se juge sur plusieurs années, dix ans ou plus. Le combat n’est jamais terminé.
Le passage du temps a une importance capitale dans votre film qui bat au rythme des saisons. Pourquoi avoir souhaité le marquer autant ? Le passage du temps était très important car c’est un personnage essentiel de la rééducation. Les progrès se voient très peu et prennent beaucoup de temps. Pour suivre l’évolution d’un cérébrolésé, il faudrait au moins avoir comme échelle de temps, une dizaine d’années. Il fallait l’éprouver, en trichant parfois au montage. Par exemple, l’évolution de la marche de Christophe, le papa, a pris un an et demi. Pour la rendre visible, palpable du moins. Elle est recréée en une séquence de quelques minutes. Les choix musicaux renforcent cette idée de temporalité, tout en commentant l’état intérieur de vos personnages. Il y a les chansons qui passent dans le centre en boucle, ils sont branchés en continue sur radio Nostalgie ou Chants de France, d’où Bécaud, Goldman, Ferré… C’est ce qu’entendent les patients tout au long de leur journée. Dans le film, la chanson de Gilbert Bécaud intervient en contrepoint. Elle raconte l’histoire d’un type qui rêve d’aller à Orly rien qu’en écoutant les avions. Elle me rappelle mon enfance. En ce qui concerne la musique de film proprement dite, c’est autre chose. Dans mes films précédents, je n’avais jamais eu recours à la musique additionnelle. C’est ma monteuse qui m’a proposé l’opus 37, Mars de Tchaïkovski et mon premier réflexe a été d’être agréablement surpris. Mais très longtemps, j’ai pensé que c’était trop sucré, qu’on faisait du cinéma de fiction. Et puis, petit à petit, je me suis dit que la perception du temps était faite de ça, de grands moments de présent, alternant avec quelque chose qui survole d’une même humeur plusieurs moments. Du présent et de l’imparfait si je puis dire. De janvier à avril, la perception du temps a été en creux, les progrès invisibles : la musique permettait ces ponts. La musique est ici sensorielle et fait narration. Par contre la musique qui vient « hanter » le présent vient de György Ligeti. C’est intéressant ce qu’il dit sur la musique et la temporalité. Sa musique, au lieu de se développer comme un récit, dans le temps et dans l’espace, se déploie verticalement, devient l’empreinte d’un instant… Ligeti, c’est un plongeon dans un supra présent à chaque fois que je l’écoute. Le morceau de No One Is Innocent est comme un cœur qui crie. Je filmais cette séance de kiné et j’ai repéré tout à coup le regard de Christophe. Je me suis arrangé pour me placer le plus proche dans l’axe de son regard, ce qui avec la nuque des gens me parait être les deux endroits où j’ai un accès vers la personne. Il m’a semblé qu’il avait un accès de conscience de l’endroit où il se trouvait. Évidemment, on est dans une hyper subjectivité. C’était une espèce de cri sourd, intérieur. En plus c’est une de ses musiques préférées, il écoute à fond de la Heavy. Pour le reste, on a apporté un soin particulier à la bande son, montage de sons de la réalité, à base de résonances, d’échos lointains de télévision, de portes qui claquent, de cris et de pas… une bande son très organique toujours dans le but de faire « ressentir » le présent.
On note, dans votre film, une dynamique entre extérieur et intérieur avec des séquences filmées à travers des vitres ou des portes coulissantes. Pourquoi ce parti pris ? Un centre de rééducation est comme une prison. C’est est un lieu étrange, une sorte de cocon. Il y a beau avoir des portes qui s’ouvrent, vous êtes toujours à l’intérieur et on ne peut pas dire malgré tout que l’extérieur n’agit pas sur vous. La notion du temps, de la même manière, est une drôle de chose pour les patients. Altérée, elle les interpelle sans cesse. Les malades se trouvent dans le vaisseau de leur propre reconstruction qui va à une vitesse extrêmement lente. Pendant ce temps dehors ça change, ça évolue, inexorablement, ça se moque du reste, ça l’ignore. J’ai tâché de faire éprouver au spectateur cette sensation ouatée d’intérieur et cet extérieur qui change de façon assez indifférente à vous-même. Filmer à travers des vitres, comme je l’ai toujours fait, souligne que la réalité est la projection d’un regard, souligne ce regard : ces personnes sont filmées par quelqu’un et ça signe le plan.
Le film se referme sur une blague éloquente de Christophe, l’ex prof de tennis, où il est question de « lunettes spéciales qui aident à mieux voir ». Souhaitiez-vous que votre documentaire remplisse la même fonction ? C’est le moment que je préfère dans le film car au fond, il résume tout. Christophe parle vraiment de la conscience « qui voit ». Cela dépasse le regard. Un moment qui a surgi comme ça. Alors si ça passe au final auprès des spectateurs, disons que le cinéma, oui, nous permet quelque chose.
Le sujet, pour finir, est particulièrement sensible pour vous, peut-on en parler ? Oui, je m’en fous. J’ai moi-même eu voilà cinq ans un AVC (accident vasculaire cérébral, ndlr), pas bien méchant, et qui ne m’a pas laissé de séquelles particulières, du moins j’aime à le croire. Je préparais un téléfilm de fiction sur le traumatisme crânien, l’après-midi, je visitais des centres de rééducation pour trouver celui dans lequel on allait tourner ; et le soir, chez moi, je me suis réveillé par terre : j’avais eu un AVC. On peut appeler ça du professionnalisme exacerbé… J’ai donc partagé pendant une brève période la vie d’un centre de rééducation. J’ai appris aussi à décrypter ce monde des soignants, vu par les patients. C’est une armée bienveillante dont on ne cite pas les noms dans le film, mais qui brille par sa présence déterminante. Et puis on découvre un sentiment d’isolement qu’il m’est difficile de communiquer, des choses insondables. J’ai ainsi éprouvé cet univers, mais la question de la conscience était bien antérieure. C’est la question essentielle qui fait que je fais du cinéma. Retrouvez la page Facebook du film !
Focus sur l'édition 2025 du Prix Com'Handicap !
Partenariat
© 2025 Talentéo. Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur.