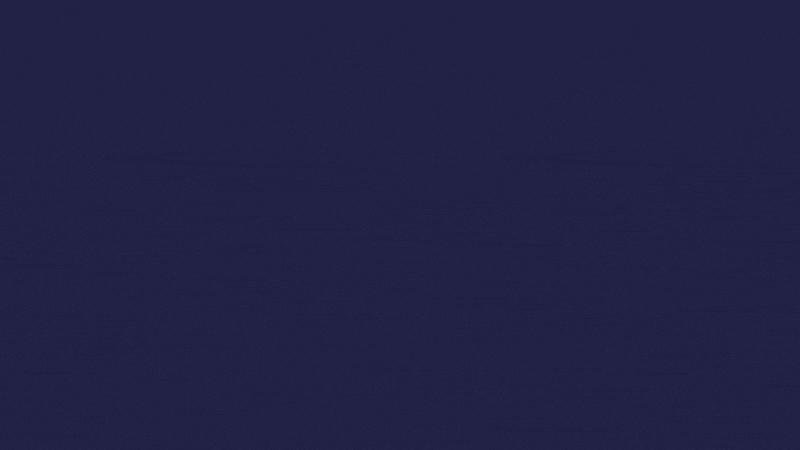Le 10 mai, c’est la journée mondiale du Lupus. Elle a pour objectif de sensibiliser le public à cette maladie chronique méconnue et assez rare. Pourtant, elle mène souvent à des complications qu’il faut prendre en compte au travail. Aujourd’hui, nous vous expliquons un peu plus en détail cette maladie et délivrons quelques pistes pour accompagner un collègue ayant un lupus.
Qu’est-ce que le lupus ?
Le lupus systémique est une maladie chronique auto-immune. Son nom complet est bien souvent « lupus érythémateux disséminé » (LED) ou encore « lupus érythémateux systémique ». (LES).
Une maladie est systémique lorsqu’elle touche différents organes. C’est pourquoi la principale difficulté liée à cette pathologie, c’est qu’il n’est pas toujours évident de la diagnostiquer.
En effet, le lupus peut se manifester de nombreuses façons à travers l’organisme. Les symptômes peuvent changer d’une personne à une autre et évoluent avec l’avancée de la maladie.
De manière caractéristique, le lupus provoque souvent les symptômes suivants :
- éruption cutanée, principalement localisée sur le visage ;
- des anomalies biologiques touchant les articulations, les organes (reins, cœur, poumons…), le sang, etc.
Il peut apparaître chez différentes personnes. Dans 2 % des cas, il se déclare chez les moins de 19 ans. Mais les plus touchés ont entre 30 et 39 ans, à plus forte raison encore chez les femmes.
Il touche en moyenne 41 personnes sur 100 000 en France métropolitaine, mais ce chiffre monte jusqu’à 127 dans les Antilles et notamment en Martinique.
Quelles sont les causes de cette maladie ?
Il existe des causes très diverses à l’apparition d’un lupus. Bien souvent, cette maladie se révèle à la suite d’un dérèglement ou d’un bouleversement comme :
- La consommation de certains médicaments, tels que les bêtabloquants, anticonvulsivants, antibiotiques. Le lupus cesse alors de se manifester lorsque le traitement est interrompu.
- Les hormones : les femmes en âge de procréer sont parfois plus fortement touchées suite à une grossesse.
- La génétique : 10 % des cas de lupus surviennent dans une famille qui a déjà connu la maladie.
- Des facteurs environnementaux divers : exposition aux rayons UV, tabac, certains virus.
Cette maladie reste rare et son mécanisme est assez mystérieux. Même avec le regard de la science actuelle, il est toujours difficile de comprendre pourquoi certains organismes développent un lupus.
Généralement, c’est avec la réaction cutanée et la dégradation des articulations qu’on voit la maladie se déclencher, dans plus de 70 % des cas. Néanmoins, certaines personnes contractent parfois cette maladie sans s’en rendre compte, dans le sang ou les reins, par exemple.
Peut-on guérir du lupus ?
Aujourd’hui, même si les traitements restent lourds, ils permettent de stabiliser la maladie pour pouvoir vivre avec. Aussi, avec un traitement adéquat, une personne atteinte du lupus pourra avoir la même espérance de vie que si elle n’avait pas contracté cette maladie auto-immune.
Pourtant, pour s’assurer que les poussées sont bien stoppées, la personne malade doit parfois prendre jusqu’à une dizaine de comprimés chaque jour.
Comment accompagner un collègue atteint de lupus ?
Pour accompagner un collègue atteint du lupus, il va falloir réfléchir à aménager son poste.
Pour éviter toute aggravation de la maladie, certains gestes doivent être adoptés au quotidien. Il faut éviter :
- le tabac ;
- l’exposition au soleil ;
- le stress ;
- la fatigue.
Des aménagements spécifiques peuvent être mis en place en fonction la partie la plus touchées. Cela peut être l’estomac, les articulations, les reins. Un poste de travail adapté pourra être de rigueur pour éviter tout inconfort au travail.
Pendant les poussées, le lupus entraîne une invalidité partielle ou totale. C’est pour cela qu’un arrêt de travail plus ou moins long peut être distribué par le médecin. Il faut même parfois envisager un mi-temps thérapeutique. Le médecin du travail apporte son soutien pour adapter le poste.
Si vous connaissez une personne atteinte d’un lupus, ou si ou vivez vous-même la maladie, nous vous invitons à venir échanger sur nos réseaux sociaux.
Rencontrez un talent !
Partenariat
© 2024 Talentéo. Toute reproduction interdite sans l’autorisation de l’auteur.